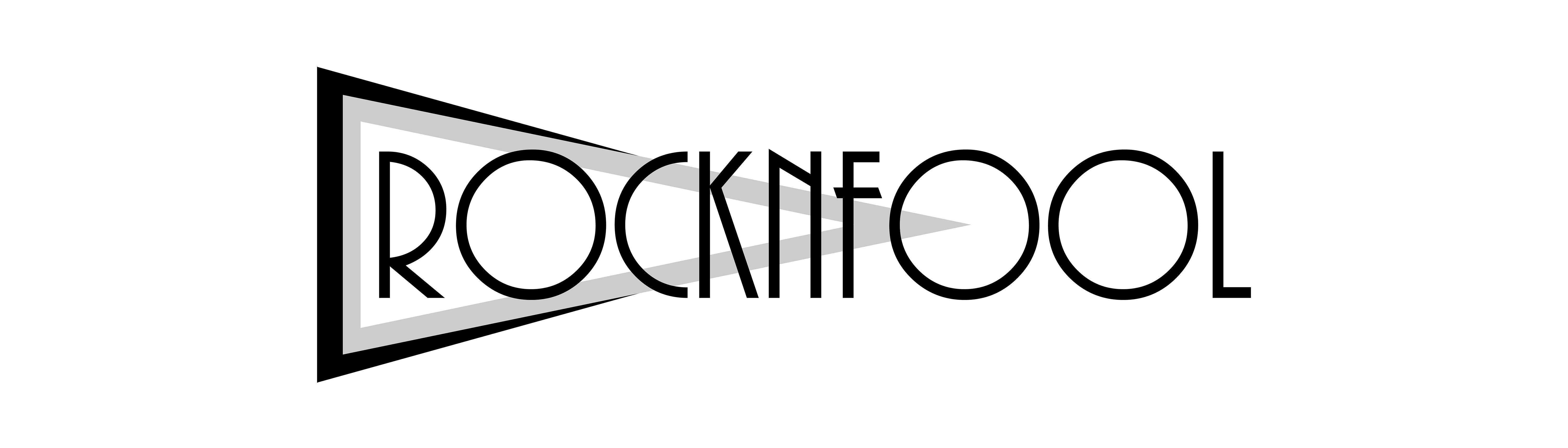Master of None : autobiographie collective d’une génération qui se cherche
CHRONIQUE – Aziz Ansari et Alan Yang ont réussi le passage compliqué de la deuxième saison avec “Master of None”. Plus intime, plus poussée, plus recherchée, elle dresse une autobiographie collective d’une jeunesse qui se cherche.
Est-ce que ça marche comme pour la musique ? Est-ce qu’on aime plus une série parce qu’elle nous renvoie à notre propre vie ? Parce qu’elle nous parle ? Parce qu’on se retrouve dans certaine situation ? Est-ce que ces questions entrent en considération et feront que l’on accroche plus ? J’en sais rien. Mais ces questions, je me les suis posées en regardant la deuxième saison de Master of None sur Netflix, du génial duo Aziz Ansari et Alan Yang. Une saison qui va en dérouter plus d’un car les deux créateurs ont radicalement transformé la forme tout en conservant le fond.
Rappel des faits : après sa rupture, Dev’ décide de quitter New York l’effervescente pour l’Italie. Modène. Son but : apprendre à faire des pâtes, sa passion culinaire. Exit le bruit, la foule. Place à la dolce vita et les clichés qui vont avec, mais qui nous font tellement rêver. C’est là-bas que l’on retrouve notre héros en questionnement perpétuel sur sa propre vie, sur ses choix et ses envies. Plus que les questions, c’est l’écriture et la réalisation du premier épisode qui marque les esprits. Image en noir et blanc, réalisation clairement inspirée du cinéma italien. C’est charmant, poétique, avec cette lenteur, cette douceur et cette moiteur que seule l’Italie maîtrise. C’est drôle aussi. Toujours. Mais façon clown triste.
Série protéiforme
Ce qui marque dans cette deuxième saison de Master of None, c’est la déconstruction de la série. Chaque épisode à sa propre forme et aucun épisode n’est construit, pensé, réalisé de la même manière. Une façon de pousser plus loin la réflexion, d’explorer encore plus les différences, de ressentir les émotions. On ne s’identifie plus aux personnages, on devient les personnages. Littéralement, comme dans cet épisode si puissant “I Love New York”. Exit Bernie, Denise et Dev’. Dans cet épisode, on suit les morceaux du quotidien de plusieurs protagonistes totalement inconnus de la série : un concierge, trois chauffeurs de taxi d’origine africaine refoulés de l’entrée d’une boîte de nuit et un couple de sourd-muets. Quand ces derniers sont à l’écran, le son s’arrête brusquement. Plus de bruitage, plus de musique. Rien. Juste un silence assourdissement. Ça rend le message encore plus puissant.

L’amour ou plutôt sa recherche incessante de l’amour est bien sûr, omniprésente. Dès le premier épisode. Dev’ rencontre par hasard une jeune Londonienne dans un restaurant. Ils passent la journée ensemble. Au moment de se quitter, ils ne s’embrassent pas mais promettent de s’appeler très vite pour passer un week-end ensemble. Ça n’arrivera pas. Dev’ se fait voler son téléphone.
La poursuite dans les rues de Modène pour retrouver l’objet chéri est révélatrice d’un fait : nous sommes accrocs à nos téléphones. Il se demande comment faire pour retrouver l’inconnue du restaurant. Il ne pourra pas et il a l’impression que tout s’effondre sous ses pieds. C’est via son téléphone qu’il essaie de trouver une nouvelle amoureuse. Via une application que l’on n’appellera pas Tinder mais qui lui ressemble quand même beaucoup. Dev’ enchaîne les rendez-vous et le téléspectateur suit pêle-mêle les dates plus ou moins ratés. De celui où l’on a rien à se dire à celui infernal qui ne finit jamais.
Autobiographie collective
Quand Aziz Ansari n’explore pas le thème de l’amour, c’est l’autre grande question existentielle de la vie qui est abordée : le travail. Quoi faire ? Faut-il rester dans un job qui nous ne plaît pas, mais nous assure un revenu sur le long voire très long terme ? Faut-il avoir les couilles de dire “non, je ne me vois pas faire ça ? Je déteste ce job ! Je veux plutôt faire ce qui me plaît ?” Les choix de vie de Dev’ nous interrogent. Ils nous rendent perplexes parfois, mais souvent ils nous renvoient à nos propres vies.

Je me suis personnellement reconnue dans certaines situations. Au moment de dire “non, je ne veux pas de ton job“. À l’époque, on m’avait proposé un CDI dans une rédaction. La licorne et la découverte de l’Atlantis en même temps. J’avais refusé car il ne correspondait pas à mes envies. Finir tous les jours à minuit ? Couvrir TPMP et autres pourritures de la télévision ? Non. J’avais associé ça à ma peur panique de l’engagement. Je ne me voyais pas du tout, passer ma vie derrière un ordinateur à écrire des articles dont je ne serais pas fière.
Je pourrais être Dev’. Beaucoup de personnes autour de moi pourraient être Dev’. Et nombre d’entre eux, ont entre 30 et 37 ans. Ces adultes qui se cherchent. Qui envient et rejettent le modèle des parents (encore plus quand ils sont enfants d’immigrés). Ils voudraient se projeter mais pas trop loin tout de même, histoire de vivre au jour le jour. Aussi. Qui, à force d’avoir le cœur brisé, ne savent plus trop s’ils veulent un coup d’un soir ou un couple pour une vie. Master of None continue à parler de nous tous, jeunes adultes paumés coincés entre la génération “stable” des parents et la “go-fast” des adolescents. Une autobiographie collective. Et si la forme à changer, c’est pour donner plus de sens au fond.
https://www.youtube.com/watch?v=tGE-Mw-Yjsk
À LIRE AUSSI
>> Love, saison 2 : l’amour est fait de hauts et de bas
>> The Handmaid’s Tale, le conte glaçant d’une société (pas) si alternative