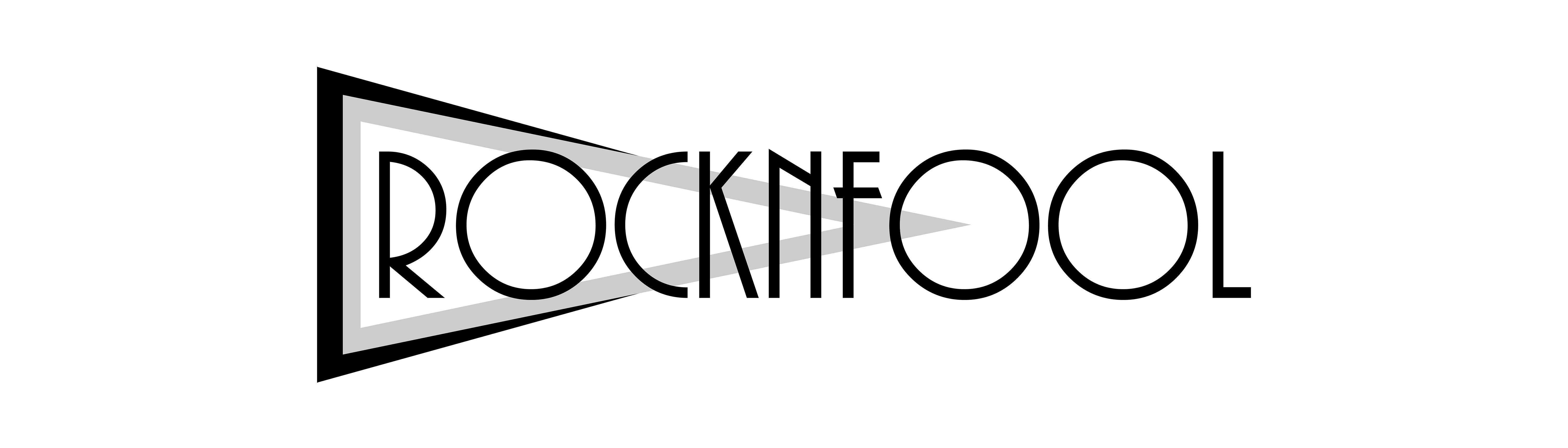Elliott Murphy le magnifique et le mythe de Gatsby
ENTRETIEN – Elliott Murphy n’est pas dans le panthéon du rock, mais assurément, il fait partie de son histoire. De rock star destinée à être le “nouveau Bob Dylan” à loser magnifique exilé à Paris, l’Américain avait tout pour réussir. Question : a-t-il pour autant raté sa vie ?
10 novembre 2017. Déjà 20h25 ! Merde. Je suis en retard. Ce soir, Elliott Murphy joue au New Morning comme une ou deux fois par an. Il est supposé commencer à 21 heures et pas de première partie. J’accélère le pas, rue Montorgueil. Il fait gris mais doux en cette soirée d’automne, je me dis que Paris est agréable le vendredi soir quand les terrasses sont prises d’assaut. On a envie de rencontres, de quelques bières, d’un peu d’ivresse et d’un horizon qui s’élargit comme en ce soir d’été de 1990 où, encore teenager, je drague cette touriste grecque blonde aux yeux bleus dans une crêperie de la rue Mouffetard.
Je la ramène dans l’appart de mes parents qui, eux, étaient en vacances, j’étais probablement collé après avoir redoublé cette année-là. Le mois d’août à Paris est magique, le soleil sur les quais, la chaleur dans les rues déserte de Saint-Germain-des-Près. À peine arrivé chez mes parents, j’ai lancé l’album Aquashow d’Elliott Murphy. “The Last Of The Rock Stars” résonne de la stéréo de mon père, nous donnant l’énergie de baiser jusqu’au petit matin.
Quelques jours avant cette rencontre, je m’étais enfin procuré ce premier album mythique de Murphy, épuisé depuis sa sortie en 1973. Il venait d’être édité pour la première fois en CD. Les trois premiers albums de Murphy, Aquashow, Lost Generation et Night Lights sont des pépites oubliées qui apparaissent régulièrement dans les listes des “lost classics”, ces albums géniaux mais méconnus, chef d’œuvres ignorés dont les magazines musicaux comme Rolling Stone ou Uncut se délectent de faire redécouvrir aux nouvelles générations. Aquashow est une masterpiece du rock, coincée entre Blonde and Blonde et Darkness of the Edge of Town. Bruce Springsteen n’était pas le nouveau Bob Dylan, mais Columbia Records aimait le placarder. Elliott Murphy aurait pu, aurait dû l’être s’il l’avait décidé et ne s’était pas fait planter.
La première fois que j’ai entendu parler d’Elliott Murphy, c’était dans un article de Rock & Folk. Le journaliste, dans sa critique de The River de Springsteen , avait écrit à propos de l’intro de la chanson qui a donné son nom à l’album : “c’est le grand frisson avec le chorus d’harmonica le plus poignant depuis Elliott Murphy sur ‘Night Lights’…”. Tiens, tiens. C’est comme si le destin de ces deux hommes était lié. Comme dans le roman de Fitzgerald. Au début, Murphy était Gastby et Springsteen, Carraway. Puis les rôles se sont inversés. Elliott Murphy, dandy échevelé à la crinière blonde, élégant, raffiné, digne héritier de Leonard Cohen, Bob Dylan ou Lou Reed. Poète, artiste, talentueux, sa plume était demandée. C’est Murphy qui a écrit les notes de l’album live posthume du Velvet Underground, 69, avec sa fameuse pochette de mauvais goût et son dessin de l’arrière train et des jarretelles d’une strip-teaseuse de seconde zone sur fond vert pomme. Il a aussi écrit les premiers articles sur Tom Waits dans Rolling Stone. Elliott Murphy était brillant comme un diamant, Billy Joel qui, comme lui venait de long Island, l’enviait et Bruce Springsteen savait au fond de lui que s’il devait y avoir un nouveau Bob Dylan, ce serait Murphy. C’était lui l’élu. Pas surprenant que Springsteen, à chaque fois qu’il venait à Paris donner un concert, invitait Murphy à venir chanter avec lui sur scène. Il sait ce qu’il lui doit.
Elliott Murphy était l’espoir du rock new-yorkais. Aquashow s’était vendu à plus d’exemplaires que les deux premiers albums de Springsteen combinés. Sa maison de disque avait placardé tous les tunnels de métro avec une affiche citant Village Voice : “Elliott Murphy gonna be a monster!”. Emballé par la promesse de ce futur doré, Murphy se forçait à jouer le jeu du “sex, drugs and rock’n’roll” dicté par l’industrie du disque des 70’s et se laissait submerger. Plus influencé par le romantisme de Fitzgerald que par les junkies du Lower East Side, il était un poète solitaire et pas un band leader. Trop romantique et idéaliste, il n’a pris de Gatsby que les excès des roaring twenties et se perdait pour finir comme tous les artistes rejetés. À Paris.
Le dossier Murphy
Paris et les pavés de la rue des Petits Carreaux, où je cours comme un dératé sous une légère pluie, me rappellent les après-midis passés avec la touriste grecque. Dans le lit de mes parents à écouter en boucle “Hometown”, “Marilyn” ou un “How’s The family”. Je cours à perdre haleine pour arriver enfin au New Morning à 21 heures pile. C’est complet. Tant mieux. Elliott Murphy est déjà sur scène. J’essaie de me tracer un chemin dans la foule compacte pour me rapprocher. Il y a dans le public cette communion particulière qui ne peut se produire qu’avec une catégorie très limitée d’artistes. Ceux qui ont réussi à tisser un lien indestructible avec leur audience. Dans leur mémoire, un événement est forcément associé à leur œuvre. Pour les 500 personnes qui remplissent le New Morning, Elliott Murphy a accompagné des pans entiers de leur existence. Moi, je l’associe à la touriste grecque et au baccalauréat raté.
Le premier set est acoustique avec son guitariste fétiche Olivier Durand, grognard fidèle. Pas mal mais rien d’inhabituel. Entracte. Bières. On retrouve des connaissances. La deuxième partie est avec un full band. Je préfère ce son. Le groupe est bon, excellent même. Deux guitaristes, son fils Gaspard à la basse et un clavier. Enfin ! Le clavier est super important pour les rockeurs mélodiques comme Murphy. Retirez les harmonies du piano de Roy Bittan et les chansons de Springsteen deviennent beaucoup plus banales. Elliott et son band jouent carré, vite et bien, les morceaux s’enchaînent sans temps mort. Sincères et généreux. Je me dis que pendant que le Boss s’emmerde à Broadway à raconter sa vie, Murphy joue devant nous avec ses chansons. C’est juste l’histoire d’un musicien expatrié américain devenu parisien qui veut donner et qui prend du plaisir à jouer du rock. Pas besoin d’une dizaine de milliers de fans. Quelques centaines suffisent. Libéré du carcan du succès, il nous donne ce soir, comme à chaque fois, un grand concert car il n’a plus rien à prouver. Ni à perdre. Juste à partager. Il rend hommage à Tom Petty avec une superbe version de “Free Fallin” puis “Rock Ballad”. Qu’est-ce qui différencie une chanson d’un hit ? Qu’est-ce qui détermine un succès ? Une carrière réussie ? Je me dis en écoutant l’intensité sublime d’”Anastasia” ou de “Diamonds By The Yard”, que ces chansons n’ont rien à envier aux tubes de Tom Petty, Billy Joel ou de Springsteen. Elliott Murphy pourrait faire le même concert à Bercy ou à l’Olympia et on se prendrait la même claque. D’après les regards aux alentours, on est 500 à se poser la même question : pourquoi est-on presque les seuls à le connaître ?
Murphy finit son set. Rappel. Triomphe. Remerciement. Il est content. Je suis bourré et revigoré du concert. On écume, avec mon frère, les bistros bobos du dixième arrondissement. Les pintes de bières ne pourront rien y changer, des questions me bousculent. Ce type pourrait être au sommet, une légende, tourner dans le monde entier, il en est conscient, il devrait être amer et frustré mais il est comblé d’avoir joué ce soir, au New Morning, rue des Petites Écuries, devant juste quelques centaines de fidèles, croyant encore au mythe de Murphy. Et bizarrement, pas de rancœur, ni d’amertume. Il était heureux d’être là. Vraiment bizarre. C’est le lendemain que je vais avoir un début de réponse. Gueule de bois. Rien de mieux pour me remettre de ma cuite que de glander sur le canapé en somnolant devant ONPC. Yann Moix va sauver les 2h48 d’émission de la platitude la plus totale et ne pas nous faire regretter in extremis d’avoir perdu autant de temps devant la télé. On parle de succès et de réussite, Yann Moix dit : “et si la réussite, au fond, c’était juste de trouver notre place dans une existence pré-destinée ?”. Et si c’était ça après tout ? Si Elliott Murphy avait juste trouvé sa place, ici à Paris ? Je rebondis : début d’une énigme, j’ouvre le “Murphy Case” officiellement.
Pas assez punk pour survivre
Le dimanche, je le contacte via les réseaux sociaux. Il me donne rendez-vous dans un bistrot, vers Bonne Nouvelle, le lendemain. Lundi à 14 heures, je suis au café qui fait face au Grand Rex. Je m’installe à une table un peu à l’écart. Derrière moi, un cadre de la BNP ou de n’importe quelle banque des environs déjeune avec une jeunette. Probablement sa maîtresse. Ils sont à l’abri des regard, affaire Weinstein oblige.
Elliott arrive, Fedora noir, perfecto cuir, jean noir. Allure de rockeur sexagénaire, le syndrome Dick Rivers en moins. On s’assoit, on commande deux cafés. J’ai l’impression de le connaître. On tourne autour du pot, on parle du concert. 25 ans qu’il joue au New Morning, c’est son antre… et puis à brûle-pourpoint, je lui demande pourquoi il n’est pas plus connu. Que s’est-il passé ? À quel moment le train a-t-il déraillé ? Murphy sourit. “Ce n’était pas pour moi”. Au départ, il ne voulait pas voguer en solo mais juste chanter dans un groupe, The Murphys avec son frère Matthew à la basse. Mais la maison de disque avait décidé que ce serait mieux de signer Elliott en singer-songwriter. Plus commercial. C’était la mode à l’époque et Matthew Murphy se retrouva relégué à l’arrière de la pochette d’Aquashow. Cette première confrontation avec le monde impitoyable de l’industrie du disque toute puissante des années 1970 laisse des traces. Il me dit “tu sais, on me compare à Springsteen mais la différence entre lui et moi est qu’il n’aurait pas pu survivre s’il n’avait pas connu la gloire, et moi je serai mort si je l’avais connue”. Tout de même, on ne choisit pas d’être chanteur pour être ignoré, alors j’insiste. Il a quand même raté une marche à un moment, non ? Il me répond, toujours avec honnêteté, qu’il a cherché à plaire à l’industrie du disque, plus qu’à ses fans, et puis il était dur à étiqueter. Ce singer songwriter habillé tout en blanc avec une attitude rebelle avait fait dire à Robert Hillburn, célèbre journaliste de rock du Los Angeles Times, qu’il était “le premier punk intello”. Intello certainement, mais pas assez punk comme Lou Reed ou Patti Smith pour survivre à la fin des seventies. Murphy n’avait aucune chance.

Pourtant comme Springsteen, encore lui, il a eu une dernière chance. Après Polydor et deux albums sur RCA, Murphy signe sur Columbia, le label de ses rêves. On est en 1977, Columbia veut rééditer le coup de Springsteen qui, après l’échec commercial de ses premiers albums, était devenu une star avec Born to Run. À cette époque, Springsteen était empêtré dans des problèmes contractuels à cause d’une bataille de managers. Il ne pouvait pas sortir d’album. Alors Columbia mise sur le pur sang Murphy. Casaque blonde, chemise à jabot, allure altière, galop entraînant, petit pas envoûtant. On embauche de superbes musiciens : de Phil Collins à Mick Taylor. L’enregistrement a lieu à Londres sous la houlette du producteur de Queen et Harry Nilsson. David Bailey signe la pochette en noir et blanc. Encore des similitudes avec Springsteen et son Born to Run. L’album s’appelle Just a Story from America. Il s’ouvre sur “Drive All Night”, hit assuré, calibré et formaté pour les charts U.S. Même Elliott était persuadé qu’il finirait dans le top ten. “Drive All Night” sera son “Born to Run”. Et puis patatras. Manque bol, pas de radio donc pas de charts. À quoi cela tient. Life is a bitch or a roll of the dice.
Murphy a raté le coche. Il lui a manqué un manager ou un bon producteur. Quoiqu’il en soit, la maison de disque perd tout intérêt et l’envoie en tournée faire les premières partie d’Electric Light Orchestra ou des Kinks comme on envoie en 1914 les Poilus des tranchés au casse pipe. Esseulé et essoré, il va lâcher l’affaire et se faire la malle en plein milieu de la tournée. Il sait que les dés sont jetés, il a compris que sa chance était passée. Dans ce café de Bonne Nouvelle, je lui demande quand exactement il en a pris conscience. Ses souvenirs sont précis. Après avoir déserté la tournée, il se lance dans deux jours non stop de défonce. Coke, alcool. Tout y passe. Il sait que c’est foutu, qu’il a tout perdu. Pendant ces deux jours, il fait le deuil de sa vie de rock star. Il n’a nulle part où aller, plus un rond et pas le choix. Il doit rentrer chez sa mère. À l’arrière d’un taxi qu’il ne pourra pas payer, défoncé au propre comme au figuré, Elliott Murphy entend à la radio le DJ d’une station new-yorkaise qui annonce que les tickets pour les trois concerts au Madison Square Garden de Bruce Springsteen se sont vendus en un temps record. Elliott éclate en sanglot. Game over.
Il me dira fataliste, l’œil un peu triste : “le plus grand péché aux États-Unis, c’est quand vous n’avez pas de succès alors que vous êtes supposés en avoir”. Après cet épisode désastreux, il quitte la musique, essaie de rentrer dans les rangs, cherche un vrai job. Il devient clerc d’avocat, mais n’étant capable de vivre qu’à travers la musique, il laisse tomber le job, les bureaux et se remet à écrire. “Mes chansons en savent plus sur ma vie que moi-même”. Et, comme tous ses héros, losers magnifiques, poètes incompris, Elliott s’est enfuit à Paris après avoir vendu sa Telecaster. Il a une petite aura en Europe. En 1971, avant de décoller avec Aquashow, c’est en jouant dans les rues et le métro qu’il s’était fait les dents. Si bien qu’à Rome, Federico Fellini le remarque et l’embauche pour un petit rôle dans Fellini Roma. Quelques années plus tard, Murphy lui enverra ses disques. Fellini prendra le temps de lui répondre, il lui écrira une lettre pour le remercier, sans préciser s’il avait aimé ou même écouté, mais en précisant qu’il ne se rappelait pas de lui.
“Je sais qui tu es, j’ai entendu dire que tu étais un has been”
Cet attachement à Paris de Murphy se concrétise après un concert au Palace en 1982. Booké en détresse et par hasard, Elliott fait un triomphe avec six rappels. Dans l’assistance, Malcom Mc Laren. Il en a finit avec Sex Pistols mais il reste un vrai manager. Il dit à Elliott que les poètes et les artistes comme lui ne peuvent survivre et n’être reconnus qu’à Paris. Ce sera donc Paris. Il s’y installe quelques années plus tard. Il rencontrera sa femme, aura un fils, s’auto-produira, s’auto-distribuera. Plus besoin de maison de disques. Libre et indépendant, bien avant tout le monde, il est suivi par un public fidèle en France mais aussi en Scandinavie, au Benelux et surtout en Espagne. Comme Sixto Rodriguez en Afrique du Sud, Elliott Murphy était, sous Franco et sa dictature, l’un de rares artistes à avoir percé. Cela n’a l’air de rien mais cela lui suffit.
Je réalise que j’ai devant moi un homme satisfait du devoir accompli. Avant de se quitter, il me raconte une dernière anecdote qui a précipité son départ pour Paris : en 1980 , il fait une brève apparition dans Downtown 81, un film culte dont le rôle principal est tenu par Jean-Michel Basquiat et dans lequel on retrouve toute la fine fleur de l’underground new-yorkais des années 1980, de Debbie Harry à James Chance. Habillé d’un manteau en fausse fourrure bleu électrique, Elliott Murphy y joue une rock star qui s’engouffre dans une limousine pour échapper à ses fans. Sur le tournage, il rencontre Basquiat, à qui il se présente : “Salut, je suis Elliott Murphy”. Basquiat répond : “Je sais qui tu es, j’ai entendu dire que tu étais un has been”. Puis, comme si de rien n’était, il propose dans la foulée à Murphy de lui acheter des tableaux pour quelques centaines de dollars afin de se payer sa came. Elliott, vexé d’avoir été traité de has been, l’envoie bouler. Pas intéressé. C’est Debbie Harry qui finit par en acheter plusieurs. Elliott Murphy : “comme quoi la vie, si j’en avais acheté un ou deux, on ne serait pas là dans ce café à discuter, et peut-être que je ne serai pas au New Morning, qui sait ?”. “Ce serait dommage”, je réponds. Il me sourit. Et là, je comprends !
Elliott Murphy sait qu’il ne fait pas partie du Panthéon du rock mais il est conscient de faire partie de son histoire. Il sait que sa musique va rester et que l’on continuera à l’écouter, à le découvrir et à le redécouvrir. Il était fait pour écrire des chansons, des livres, c’est ce qu’il a fait. Tout n’est pas bien, mais il sait que certains tires, certains albums vont rester. On se serre la main, je le regarde au travers de la vitre s’éloigner sous la pluie. Il va rentrer chez lui, retrouver sa femme. Il passera quelques jours à écrire, à composer, à regarder de sa terrasse les toits de Paris, du Sacré-Cœur à la Tour Eiffel, puis il ira donner quelques concerts. Enregistrera quelques nouveaux titres suivant son humeur. Sans pression. Il ira jouer quelques uns de ses anciens morceaux devant ses fans fidèles. Que demander de plus ? Je me dis alors, en cette fin d’après-midi pluvieuse, qu’Elliott Murphy est quelqu’un qui a réussi sa vie. Il a su trouver sa place. La classe.
Laurent Lugosy